Foi et fidélité : une lecture croisée du judaïsme et du christianisme
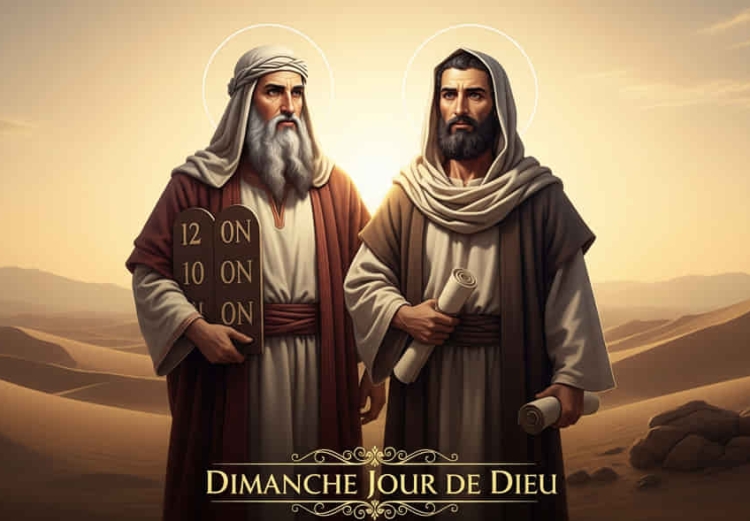
Dimanche, jour de Dieu.
La pensée rétrocède dans le temps, et dans l’espace bibliques pour méditer les concepts de foi et de fidélité. Elle va pointer les conceptions du judaïsme et du christianisme, en ce qui les rapproche et les sépare.
On a tendance à projeter l'idéologie chrétienne sur toutes les autres religions révélées, en considérant toute croyance religieuse comme une foi. C'est une erreur qui empêche de comprendre l'histoire même des religions.
Chaque religion devrait être analysée en fonction de ses fondamentaux et de son vocabulaire propre. Cet aspect est important si l’on veut traiter des rapports entre le judaïsme et le christianisme.
La religion d'Israël ne concevait pas la croyance en Dieu comme une foi — au sens que ce mot a pris chez les chrétiens, dans le cadre d’un judaïsme déjà hellénistique sous l'occupation romaine. L’Ancien Testament ne contient pas des injonctions à croire, ni des prescriptions de ce que les chrétiens appellent "la foi".
Certes, on trouvera ici et là des encouragements à la croyance dans la Thora. Mais il s'agit d’injonctions à demeurer fidèle à l'Alliance que Dieu a conclue avec Israël. Il n'y a pas de prosélytisme dans le judaïsme. Cette fidélité d'Israël est plus l'expression d'un loyalisme religieux, voire ethnique, qui consiste à observer la Loi que Dieu a révélée à ce peuple.
Il nous faut donc distinguer la Loi vétérotestamentaire et la Foi néotestamentaire. Il en ressort comme une transformation du concept de fidélité. Cette bonne Nouvelle de l'avènement messianique n'ayant pas été reçue par Israël, Saint Paul — le plus grand théologien de tous les temps — dira donc que le christianisme est une nouvelle religion, dans laquelle on entre par la conversion individuelle et personnelle, indépendamment de l'appartenance ethnique.
La forme de cette religion est ainsi congrégationnelle : c'est une Assemblée de croyants dans une Église. Quand les chrétiens parlent du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, c’est selon l’esprit — et non pas la lettre.
Eh Dieu !
Exégèse du texte de Paul Zahiri
Dans ce texte puissant, Paul Zahiri nous convie à un voyage de pensée critique et théologique autour des concepts de foi et de fidélité, tels qu'ils sont entendus dans les traditions religieuses juive et chrétienne.
Le cœur de son analyse repose sur une idée centrale : la confusion fréquente, dans les esprits modernes, entre foi (au sens chrétien) et fidélité (au sens juif). Il dénonce une projection du christianisme sur toutes les religions, qui en fausse l’interprétation historique.
1. Foi et fidélité : des concepts disjoints
Zahiri montre que le judaïsme ancien ne parlait pas de foi au sens chrétien, mais de fidélité à l’alliance. Ce n’était pas tant la croyance qui importait que l’observance de la Loi (la halakha), reçue dans un cadre collectif et ethnique.
La foi chrétienne, en revanche, est d’ordre individuel, intérieur, et universel. C’est une réponse personnelle à l’appel du Christ — indépendante de l’héritage ethnique.
2. Rupture théologique : Saint Paul et l’Église
Saint Paul est évoqué comme le penseur du tournant. Pour lui, la fidélité juive ne suffit plus : c’est par la foi en Jésus-Christ que s’accomplit désormais le salut. Cette foi n’est plus liée à une appartenance ethnique ou nationale, mais à une démarche spirituelle.
Le christianisme se constitue alors comme une religion de conversion, non de naissance. L’Église devient une assemblée ouverte — ce qui implique une universalité nouvelle.
3. Esprit et lettre
Le texte se conclut sur une réflexion inspirée par la célèbre formule : « Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ». Pour Zahiri, la référence chrétienne à ces patriarches relève d’une appropriation spirituelle, non littérale. Elle repose sur une relecture « selon l’esprit » — dans la logique de Saint Paul et des Pères de l’Église.
Ainsi, la « fidélité » change de nature : d’un loyalisme communautaire, elle devient adhésion intérieure à une révélation.
Glossaire
- Alliance (berith) : pacte établi entre Dieu et Israël dans l’Ancien Testament, basé sur l’obéissance à la Loi.
- Ancien Testament : ensemble des textes sacrés communs au judaïsme et au christianisme, avant la venue du Christ.
- Foi (chrétienne) : adhésion personnelle, libre et consciente à la personne du Christ et à son message.
- Fidélité (judaïque) : respect de la Loi mosaïque et attachement collectif à l’Alliance de Dieu avec le peuple d’Israël.
- Hellénisme : influence culturelle grecque sur les peuples et les religions de l’Orient ancien, notamment le judaïsme après Alexandre le Grand.
- Judaïsme : religion monothéiste fondée sur la Thora, le Talmud et l’observance des commandements (mitsvot).
- Loi (Torah) : ensemble des commandements donnés par Dieu à Moïse, constitutifs de l’identité religieuse juive.
- Messianisme : espérance d’un sauveur (le Messie) chez les juifs ; accomplie pour les chrétiens dans la personne de Jésus-Christ.
- Nouvelle Alliance : dans le Nouveau Testament, alliance spirituelle proposée à tous les peuples par la foi en Jésus.
- Prosélytisme : volonté active de convertir les autres à sa propre religion — absent du judaïsme ancien.
- Saint Paul : apôtre et théologien majeur du christianisme primitif, auteur de nombreuses épîtres du Nouveau Testament.
- Thora : cinq premiers livres de la Bible (Pentateuque), texte fondamental du judaïsme.
- Vétérotestamentaire / Néotestamentaire : relatifs respectivement à l’Ancien et au Nouveau Testament.
Dimanche, jour de Dieu.
La pensée rétrocède dans le temps, et dans l’espace bibliques pour méditer les concepts de foi et de fidélité. Elle va pointer les conceptions du judaïsme et du christianisme, en ce qui les rapproche et les sépare.
On a tendance à projeter l'idéologie chrétienne sur toutes les autres religions révélées, en considérant toute croyance religieuse comme une foi. C'est une erreur qui empêche de comprendre l'histoire même des religions.
Chaque religion devrait être analysée en fonction de ses fondamentaux et de son vocabulaire propre. Cet aspect est important si l’on veut traiter des rapports entre le judaïsme et le christianisme.
La religion d'Israël ne concevait pas la croyance en Dieu comme une foi — au sens que ce mot a pris chez les chrétiens, dans le cadre d’un judaïsme déjà hellénistique sous l'occupation romaine. L’Ancien Testament ne contient pas des injonctions à croire, ni des prescriptions de ce que les chrétiens appellent "la foi".
Certes, on trouvera ici et là des encouragements à la croyance dans la Thora. Mais il s'agit d’injonctions à demeurer fidèle à l'Alliance que Dieu a conclue avec Israël. Il n'y a pas de prosélytisme dans le judaïsme. Cette fidélité d'Israël est plus l'expression d'un loyalisme religieux, voire ethnique, qui consiste à observer la Loi que Dieu a révélée à ce peuple.
Il nous faut donc distinguer la Loi vétérotestamentaire et la Foi néotestamentaire. Il en ressort comme une transformation du concept de fidélité. Cette bonne Nouvelle de l'avènement messianique n'ayant pas été reçue par Israël, Saint Paul — le plus grand théologien de tous les temps — dira donc que le christianisme est une nouvelle religion, dans laquelle on entre par la conversion individuelle et personnelle, indépendamment de l'appartenance ethnique.
La forme de cette religion est ainsi congrégationnelle : c'est une Assemblée de croyants dans une Église. Quand les chrétiens parlent du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, c’est selon l’esprit — et non pas la lettre.
Eh Dieu !
Exégèse du texte de Paul Zahiri
Dans ce texte puissant, Paul Zahiri nous convie à un voyage de pensée critique et théologique autour des concepts de foi et de fidélité, tels qu'ils sont entendus dans les traditions religieuses juive et chrétienne.
Le cœur de son analyse repose sur une idée centrale : la confusion fréquente, dans les esprits modernes, entre foi (au sens chrétien) et fidélité (au sens juif). Il dénonce une projection du christianisme sur toutes les religions, qui en fausse l’interprétation historique.
1. Foi et fidélité : des concepts disjoints
Zahiri montre que le judaïsme ancien ne parlait pas de foi au sens chrétien, mais de fidélité à l’alliance. Ce n’était pas tant la croyance qui importait que l’observance de la Loi (la halakha), reçue dans un cadre collectif et ethnique.
La foi chrétienne, en revanche, est d’ordre individuel, intérieur, et universel. C’est une réponse personnelle à l’appel du Christ — indépendante de l’héritage ethnique.
2. Rupture théologique : Saint Paul et l’Église
Saint Paul est évoqué comme le penseur du tournant. Pour lui, la fidélité juive ne suffit plus : c’est par la foi en Jésus-Christ que s’accomplit désormais le salut. Cette foi n’est plus liée à une appartenance ethnique ou nationale, mais à une démarche spirituelle.
Le christianisme se constitue alors comme une religion de conversion, non de naissance. L’Église devient une assemblée ouverte — ce qui implique une universalité nouvelle.
3. Esprit et lettre
Le texte se conclut sur une réflexion inspirée par la célèbre formule : « Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ». Pour Zahiri, la référence chrétienne à ces patriarches relève d’une appropriation spirituelle, non littérale. Elle repose sur une relecture « selon l’esprit » — dans la logique de Saint Paul et des Pères de l’Église.
Ainsi, la « fidélité » change de nature : d’un loyalisme communautaire, elle devient adhésion intérieure à une révélation.
Glossaire
- Alliance (berith) : pacte établi entre Dieu et Israël dans l’Ancien Testament, basé sur l’obéissance à la Loi.
- Ancien Testament : ensemble des textes sacrés communs au judaïsme et au christianisme, avant la venue du Christ.
- Foi (chrétienne) : adhésion personnelle, libre et consciente à la personne du Christ et à son message.
- Fidélité (judaïque) : respect de la Loi mosaïque et attachement collectif à l’Alliance de Dieu avec le peuple d’Israël.
- Hellénisme : influence culturelle grecque sur les peuples et les religions de l’Orient ancien, notamment le judaïsme après Alexandre le Grand.
- Judaïsme : religion monothéiste fondée sur la Thora, le Talmud et l’observance des commandements (mitsvot).
- Loi (Torah) : ensemble des commandements donnés par Dieu à Moïse, constitutifs de l’identité religieuse juive.
- Messianisme : espérance d’un sauveur (le Messie) chez les juifs ; accomplie pour les chrétiens dans la personne de Jésus-Christ.
- Nouvelle Alliance : dans le Nouveau Testament, alliance spirituelle proposée à tous les peuples par la foi en Jésus.
- Prosélytisme : volonté active de convertir les autres à sa propre religion — absent du judaïsme ancien.
- Saint Paul : apôtre et théologien majeur du christianisme primitif, auteur de nombreuses épîtres du Nouveau Testament.
- Thora : cinq premiers livres de la Bible (Pentateuque), texte fondamental du judaïsme.
- Vétérotestamentaire / Néotestamentaire : relatifs respectivement à l’Ancien et au Nouveau Testament.
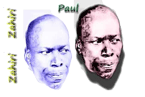
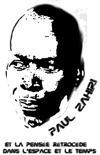
Comments est propulsé par CComment